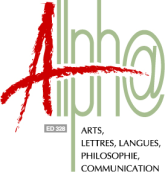-
Partager cette page
Séminaires transversaux de l'École doctorale
Pour voir les anciens séminaires transversaux de l'École doctorale ALLPH@, cliquez ici)
2024-2026
Epistémologie du processus créateur : pour des outils théoriques en recherche-action théâtrale et littéraire.
Ce séminaire en recherche-création vise à proposer des outils de réflexion pour comprendre à quel point créer n’est pas seulement un art de faire, mais un art de défaire – et de se défaire. Si ces « méthodes » et manières de procéder ont été décrites par certains créateurs eux-mêmes, elles ont aussi alimenté des discours critiques qui, à partir de notions philosophiques, nous permettent de comprendre a postériori des courants esthétiques, tout en usant d’outils transdisciplinaires, pour resituer l’acte de créer dans une perspective anthropologique : que veut dire créer ? Créer, n’est-ce pas aussi se créer ? En quoi l’expérience de création est-elle une manière de produire du savoir, mais aussi de questionner les savoirs ?
Ce séminaire placera la question de l’écriture au centre de son propos, en tant qu’elle est un outil concret de transformation intérieure, de transformation du regard. Au croisement entre la littérature et les arts du spectacle, nous aimerions nous interroger sur la pratique du théâtre, sur la manière dont elle est interrogée par les praticiens eux-mêmes, du point de vue du plateau, mais surtout du point de vue de l’écriture dramatique. Et aussi, dans une perspective plus large, interroger les relations de l’écriture à l’espace - du dehors comme du dedans.
L’objectif de ce séminaire est d’ouvrir des perspectives pour les doctorats en recherche-création littéraire, en alliant outils théoriques et pratiques, de manière à tisser un pont entre philosophie et création, et permettre d’articuler les trois parties de ce nouveau doctorat (dimension créative, dimension autoréflexive, dimension théorique) en ouvrant un champ d’approche transversal qui relève de l’épistémologie du processus créateur. L’écriture comme processus est déjà étudiée dans le champ des études de génétique textuelle, qui évaluent la production de brouillons d’écrivains dans une durée, et dans le cadre de la pratique des ateliers d’écriture créative. Il s’agit ici d’étudier le processus créateur, non d’un point de vue rhétorique, mais d’un point de vue anthropologique et philosophique, en montrant comment il délimite à la fois un champ d’expérience et un outil de connaissance propre à réorganiser les savoirs, notamment littéraires, mais aussi dans le champ des arts du spectacle, dans le cadre d’une approche heuristique.
L’idée de ce séminaire est de croiser des praticiens d’horizons différents, de manière à initier une dynamique entre chercheurs/chercheuses confirmé-e-s, doctorant-e-s et post-doctorant-e-s, ainsi que des artistes.
Cette dynamique, qui s’inscrit dans des projets en cours et des réalisations récentes, permet de prolonger la réflexion initiée par deux collections en recherche-création récemment fondées par Lydie Parisse :
- Prémices (prix d’écriture dramatique étudiant, éditions Domens) : fondée en 2021, 3 volumes parus.
- Processus créateurs (éditions Classiques Garnier) : fondée en 2023, 1 volume paru.
Il fait suite à six parutions (2019-2024) :
- Lydie Parisse, Les Voies négatives de l’écriture dans le théâtre moderne et contemporain (Classiques Garnier, 2019)
- L. Parisse (dir.), Prémices 1. Prix d’écriture théâtre/poésie orale (Domens 2022)
- L. Parisse (dir.), Premices 2. Prix d’écriture théâtre/poésie orale (Domens 2022)
- L. Parisse et Tomasz Swoboda (dir) : Voie négative, Cahiers Erta, n°33, Gdansk, 2023
- L. Parisse et T. Swoboda (dir) : Processus créateur et voies négatives, Revue des Lettres modernes, Série Processus créateurs, N°1, Lettres Modernes Minard/Classiques Garnier, 2024.
- L. Parisse (dir.), Prémices 3. Prix d’écriture théâtre/poésie orale (Domens 2024)
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
---> Lydie PARISSE (UT2J, PLH-ELH - lydie.parisse@gmail.com)
Lydie Parisse est Maîtresse de conférences Habilitée à Diriger les Recherches en Littérature française et en Arts du spectacle à l’Université de Toulouse 2 Jean Jaurès, et également écrivaine, metteuse en scène et co-directrice artistique de la compagnie Via Negativa. Sa pratique artistique et sa recherche sont étroitement liées. Membre du réseau international de chercheurs Theorias, elle a publié aux Classiques Garnier sept ouvrages critiques (dont 3 collectifs) sur les liens entre littérature et discours mystique, et sur le théâtre de Novarina, de Beckett, ainsi qu’une monographie sur Lagarce. Son dernier ouvrage personnel, Les Voies négatives de l’écriture dans le théâtre moderne et contemporain, paru en 2019, a été suivi de deux co-directions d’ouvrages collectifs avec Tomasz Swoboda : Voie négative (Cahiers ERTA, 2023), et Processus créateurs et voie négatives (Classiques Garnier, 2024) suite au colloque international en recherche-création qui s’est tenu à Toulouse en 2022. Elle a récemment fondé, avec les éditions Domens et le master création littéraire de Toulouse, le prix littéraire Prémices : un prix d’écriture dramatique, avec publication à la clé, destiné aux étudiants, dont 3 volumes sont parus. Elle dirige la collection Processus créateurs aux Classiques Garnier.
---> Tomasz SWOBODA (Université de Gdansk - swobodato@gmail.com)
Tomasz Swoboda est essayiste, traducteur, et Professeur à l’Université de Gdansk, auteur d’une thèse sur Georges Bataille. Ses travaux portent sur l’art et la littérature (Histoires de l’oeil, 2013), l’anthropologie du spectacle, les arts performatifs, et la traduction. Il a traduit en polonais une vingtaine d’ouvrages, dont les oeuvres de Baudelaire, Nerval, Proust, Barthes, Bataille, Caillois, Leiris, Ricoeur, Didi-Huberman, Mouawad, Le Corbusier ainsi que la série BD Ariol.
INTERVENANT.E.S UT2J
---> Flore GARCIN-MARROU (UT2J, LLA CREATIS - flore.gm@gmail.com)
Flore Garcin-Marrou est Maîtresse de conférences en Arts de la scène à l’Université de Toulouse 2 Jean Jaurès. Elle est l’auteure d’une thèse intitulée « Gilles Deleuze, Félix Guattari : entre théâtre et philosophie. Pour un théâtre de l’à venir » sous la direction de Denis Guénoun (Université Paris-Sorbonne, 2011). La relation entre le théâtre et les sciences humaines est le centre de gravité de ses recherches. Son intérêt pour les mystiques date de 2002, lorsqu’elle rédige un mémoire de maîtrise en Philosophie de la religion sur la « mise en scène de l’état de grâce » sous la direction de Françoise Bonardel à l’Université Paris 1. Elle a publié : En 2012, « Le théâtre, creuset de l’image spirituelle, de Maeterlinck à Beckett », dans Le Discours mystique dans la littérature et les arts de la fin du XIXe s. à nos jours, Lydie Parisse dir., Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », série Études dix-neuvièmistes, n° 31, p. 141-154. En 2014, « La mise en scène de l’état de grâce dans le théâtre de Valère Novarina » dans la Revue Littératures sur Valère Novarina : une poétique théologique ?, Olivier Dubouclez dir., n° 176, p. 67-76.
---> Samuel LHUILLERY (UT2J, CAS - lhuillery.samuel@gmail.com)
Samuel Lhuillery est Post-doctorant à l’université de Toulouse 2 Jean Jaurès, au sein du projet ANR American Theatre in France (ACTIF), dirigé par Emeline Jouve. Docteur en études théâtrales à l’Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle, il a soutenu une thèse, sous la direction de Marco Consolini, s’intitulant « Grotowski et la « Tribu » du théâtre rituel : liminalité, performance, interculturalité et interconnexions dans la pratique et la pensée théâtrales de Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Richard Schechner et Victor Turner. »
---> Aline WIAME (UT2J, ERRAPHIS - aline.wiame@univ-tlse2.fr)
Aline Wiame est Maîtresse de conférences en art et philosophie à l’université de Toulouse 2 Jean Jaurès, et membre de l’Institut universitaire de France. Spécialiste de l’oeuvre de Deleuze, sur lequel elle a soutenu une thèse à l’Université Libre de Bruxelles, elle travaille sur les arts de la scène, sur les humanités écologiques et sur la recherche-création artistique envisagée comme un mode de la recherche universitaire. Elle a publié Scènes de la défiguration : Quatre propositions entre théâtre et philosophie (Paris, Les Presses du Réel, 2016), et co-dirigé six ouvrages collectifs portant sur Deleuze, Etienne Souriau, et les relations entre l’art et la philosophie.
---> Lydie PARISSE (UT2J, PLH-ELH - lydie.parisse@gmail.com)
Le séminaire se déroule sur trois séances ; il est vivement conseillé de les suivre toutes afin que le dialogue et les échanges aient lieu en continu.
Séance 1 ---> JEUDI 6 MARS 2025
Séance 2 ---> JEUDI 13 MARS 2025
Séance 3 ---> JEUDI 20 MARS 2025
En ouvrant le lien vers Fabula, vous obtiendrez le programme détaillé avec le résumé précis de toutes les interventions qui vont être faites et des renvois vers des articles et publications :
https://www.fabula.org/actualites/125612/seminaire-doctoral-transartistique-et-transdisciplinaire-de-l-ecole-doctorale-allph-universite-de.html
Les doctorant.e.s qui souhaitent suivre le séminaire en distanciel doivent s'inscrire via le mail : ibtissemgr47@gmail.com
2023-2025
Développer la critique esthétique et politique de la littérature et des arts contre les (auto)censures sociales et morales en recherche et en pédagogie
Nous réunirons autour d’une table les enseignant.e.s chercheurs et chercheuses, les doctorant.e.s, les étudiant.e.s, les autres personnels de l’université qui le souhaitent, à l’occasion de ce séminaire pluri- et inter-disciplinaire où nous entendrons des universitaires de disciplines différentes pendant une première partie de séance autour de notre sujet. Ces prises de parole seront suivies à chaque fois d’un atelier éditorial animé par les organisatrices en vue de la rédaction collective d’un ouvrage ou numéro de revue sur ces questions (échéance 2025-2026). Ce travail de recherche ouvert et pluraliste permettra d’esquisser une théorisation polyphonique des nouvelles ou faussement nouvelles censures et des méthodologies critiques et approches esthétiques et politiques que nous pouvons adopter en vue d’une meilleure vie académique. Pour éviter les censures et les auto-censures sociales et morales dans le cadre de la recherche, de la recherche-création et de l’enseignement, nous explorerons entre autres ces grands axes de réflexion épistémologique : admettre le conflit pour éviter la violence dans nos activités universitaires d’enseignement, de création et de recherche ; développer la critique esthétique et politique en place de la censure « ressentiste » ; penser la relation scientifique, artistique et pédagogique sur un mode dialogique.Séance 1 ---> LUNDI 20 JANVIER 2025
Muriel PLANA et Nathalie VINCENT-ARNAUD - Animation table ronde
Fabrice CHASSOT (PLH) :
« La querelle Ronsard, Chénier, complices de la culture du viol »
Séance 2 ---> VENDREDI 14 FEVRIER 2025
Muriel PLANA et Nathalie VINCENT-ARNAUD - Animation table ronde
Anne PELLUS (LLA-CREATIS) :
« Du cours d'analyse de spectacles à « l’atelier du spectateur » : réflexions sur les conditions de possibilité d’un espace de conflictualité productive »
Séance 3 ---> LUNDI 17 MARS 2025
Muriel PLANA et Nathalie VINCENT-ARNAUD - Animation table ronde
Muriel PLANA (LLA-CREATIS) :
« Distinguer les approches sociologiques des approches esthético-politiques : Identité vs identification / distanciation, présence vs représentation. »
Séance 4 ---> VENDREDI 4 AVRIL 2025
Muriel PLANA et Nathalie VINCENT-ARNAUD - Animation table ronde
Nathalie VINCENT-ARNAUD (CAS) :
« (Auto-)censures et silences : du texte littéraire à sa réception à travers quelques exemples »
Théories féministes face aux gestes de créations cinématographiques : dynamiques, places, interactions, déplacements.
Le film de Chantal Akerman Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, élu en 2023 meilleur film de l’histoire du cinéma par les critiques de Sight and Sound, constitue depuis la fin des années soixante-dix l’un des films-emblèmes des mouvements féministes. Pour autant, Chantal Akerman, en 1975, ne se proclamait pas « féministe », ce qui suscita la question d’Angela Martin dans le numéro 3 (1979) de Feminist Review : « Une cinéaste qui déclare ne pas être féministe peut-elle réaliser des films féministes ? ». Un débat fécond s'ensuivit. Si ce film ne peut être unilatéralement interprété comme un acte de dénonciation envers l’ordre établi – conséquence de la domination patriarcale qui voit les femmes être seules en charge de la besogne ménagère – il n’en demeure pas moins un geste politique qui, loin de l’incriminer, proclame la prégnance du quotidien domestique au sein même de nos existences.L’exemple de Jeanne Dielman trace l’un des premiers jalons de réflexion de ce séminaire doctoral. Comment certaines œuvres cinématographiques deviennent-elles des films-totems des mouvements féministes ? Il s’agira de dresser l’évolution historique de ce processus et d’analyser les modalités de ces « iconisations progressives », d’en dresser l’évolution historique. À l’inverse, comment des films tels que Baise-moi (2000) de Virginie Despentes ou plus récemment Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma (2019) deviennent-ils des catalyseurs d’une évolution sociale, influant simultanément sur les théories féministes et la société elle-même ?
Un autre volet analytique concerne les dynamiques qu’induisent les théories et les mouvements féministes sur la production cinématographique. Les exigences de parité, l’apparition de motifs récurrents et célébrés, l’émergence de nombreux festivals spécialisés dans les films de femmes (Festival de Créteil par exemple) constituent des forces qui modifient l’écosystème du cinéma contemporain. On interrogera ainsi la question de la fabrique de l’œuvre. La place des discours féministes dans les politiques publiques (notamment celles menées par le CNC) ainsi que dans la société, influence le geste de création cinématographique en modifiant les équilibres genrés au sein de l’équipe de film. La dynamique de l’équipe autour de la question du genre est devenue incontournable et âprement discutée, ce qui modifie son acte de création et de réception. À titre d’exemple, la bande dessinée Persepolis et le film éponyme de Marjane Satrapi sont des objets d’analyses très riches au prisme de cette problématique. La place de sa créatrice (qui en est également le personnage principal), la genèse du film coréalisé avec Vincent Paronnaud ainsi que la constitution d’une équipe d’animation plus féminisée que celles des films produits à l’époque (sans que la parité soit atteinte) seront interrogées. Un autre cas exemplaire de ces choix concernant les équipes de tournage a été revendiqué et remarqué pour le long métrage de fiction lesbo-pornographique de la cinéaste argentine Albertina Carri : Las hijas del fuego (2018), mettant en évidence la possibilité, dans le contexte de l’Argentine post-Ni Una Menos, de réaliser collectivement un projet pornographique relativement « grand-public », un « porno Disney » selon la cinéaste, qui à la fois rend compte et participe de l’activisme sexo-dissident.
Il s’agira dans ce séminaire doctoral d’analyser comment les théories féministes, productrices d’une pensée sociale et historique, considèrent les œuvres cinématographiques comme un enjeu simultanément discursif et performatif, construisant sans cesse des interactions avec la vie. Mettre en question le film pour mettre en question la société : qu’est-ce que cela signifie exactement ? Comment les théories féministes enjoignent-elles à penser le film comme un horizon social, politique ? Comment les théories filmiques analysent-elles, sous le double prisme génétique et esthétique, des œuvres qui ne sont pas toujours construites dans une visée politique ? Et finalement, comment l’œuvre, entité toujours autonome, contribue-t-elle par sa puissance d’interpellation à effacer les séparations des champs épistémiques et disciplinaires pour solidariser une « pensée-constellation » qui échappe à tout processus de pétrification et d'enfermement théorique ?
INTERVENANTES
Michèle SORIANO - CEIIBA (Centre d’Études Ibériques et Ibéro-Américaines). PhD Université de Pittsburgh, Professeure au Département d’études hispaniques et hispano-américaines de l’Université Toulouse Jean Jaurès. Ses recherches portent sur les féminismes latino-américains, les épistémologies (trans)féministes et queer latino-américaines, l'analyse des discours féministes, queer et contre-hégémoniques dans la littérature et le cinéma, ainsi que sur les questions méthodologiques que pose la mise en lumière de ces discours. Parmi ses publications : Soriano, Michèle (dir.), Féminismes latino-américains en traduction. Territoires dis-loqués (2020), Mullaly, Laurence et Soriano, Michèle (dir.), De cierta manera. Cine y género en América latina (2014) ; Soriano Michèle, « Screening sex. Agencia y pornografía en las obras de Albertina Carri », Kamchatka. Revista de análisis cultural, No 19, 2022, p. 81-113. Soriano, Michèle, « La bella tarea : queeriser l’enfantement », L’Ordinaire des Amériques [En ligne], No 228, 2022, URL : http://journals.openedition.org/orda/7161; Soriano, Michèle, « Des poupées et des chiennes. Queer/cuiriser les hétérotopies », Lectures du genre [en ligne] No 15 – « Boop oop a doop… Babies, pets and poodles », novembre 2021, URL : https://lecturesdugenre.fr/category/numero-15-performance-et-liberte-boop-oop-a-doop-babies-pets-and-poodles/ ; Soriano Michèle, Maury Cristelle et Courau Thérèse, « Muere Monstruo Muere : sous le gore, le genre… ou comment représenter les féminicides », Genre en séries [En ligne], No 11, 2020, URL : http://journals.openedition.org/ges/1049.
Christelle MAURY - CAS (Centre for Anglophone Studies) est maître de conférences en anglais et études filmiques à l’Université de Toulouse – Jean Jaurès, enseignante-chercheure au laboratoire CAS EA 801. Membre de la Structure collaborative de recherches ARPEGE (approches pluridisciplinaires des études sur le genre et les sexualités)
Corinne MAURY - LLA CREATIS (Laboratoire Lettres, Langages et Arts) est maître de conférences HDR en esthétique du cinéma à l’Université de Toulouse – Jean Jaurès. Elle a publié Jeanne Dielman, 23 quai du commerce 1080 Bruxelles (Yellow Now, 2020). Du parti pris des lieux dans le cinéma contemporain (Hermann, 2018 & Edinburgh University Press, 2022), L'Attrait de la pluie (Yellow Now, 2013), Habiter le monde. Éloge du poétique dans le cinéma du réel (Yellow Now, 2011). Elle a notamment co-dirigé Béla Tarr, De la colère au tourment (Yellow Now, 2016), Raymonde Carasco et Régis Hébraud : à l’œuvre (PUP, 2016), Ecrire l’analyse de film. Un enjeu esthétique (Revue Théorème, 2019) et Lav Diaz : faire face (Post Éditions, fin 2021). Ses recherches portent principalement sur le cinéma contemporain (fiction et documentaire), sur l’espace au cinéma (lieu, paysage, territoire) et sur les formes quotidiennes de vie.
Séance 1 ---> VENDREDI 4 AVRIL 2025 (initialement programmée le 31/01/2025)
Séance 2 ---> VENDREDI 21 MARS 2025 matin
Séance 3 ---> VENDREDI 21 MARS 2025 après-midi
Séance 4 ---> VENDREDI 11 AVRIL 2025