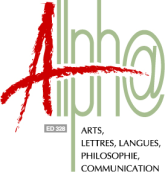-
Partager cette page
Anciens séminaires transversaux
2022-2024
Problèmes (de) critiques
Voies négatives et processus d'écriture : pour des outils théoriques en recherche-création.
2021-2023
La conversation médiatique et médiatée, entre civilité et socialité.
Pour une axiologie des arts et des lettres : valeur des œuvres et discours des valeurs.
2020-2022
Genres et sexualités dans la culture moderne et contemporaine (XIXe-XXIe siècles)
Littérature de voyage
2019-2021
Formes et fonctions du végétal dans les arts. Des processus de création aux modèles de réflexion
La retraduction : lieu et moment d'interprétation. Pour une histoire culturelle de la subjectivité en retraduction
2018-2020
Art(s) et Littérature(s)
Nouvelles mythologies et expérimentations narratives
2017-2019
La question de la métaphore
Traduction et recherche : traduire ce qui a disparu.
2016-2018
Régimes de vérité
2016-2017 ⇒ Antiquité – Renaissance – Age classique
2017-2018 ⇒ Antiquité – Modernité
La matière médiévale dans les arts et la littérature : résurgence, détournement, réappropriation.
2015-2017
Genre et cultures : œuvres de rupture.
2015-2016
Enjeux de l'intermédialité pour le théâtre contemporain
Lieux mineurs : dispositifs esthétiques et enjeux politiques.
2014-2016
Traités et théorie dans les arts et la littérature en Europe (XIVe-XIXe siècles)
2014-2015
Politiques culturelles et enjeux de l'intermédialité pour le théâtre contemporain
Images des lieux : dispositifs esthétiques et enjeux politiques.
2012-2014
Traductologie : histoire et démarche épistémologique.
Dispositifs et création : textes, images, médias, arts.
L'évolution des notions de « civil, civilité, civilisation » dans la pensée et la recherche universitaire
2011-2013
Foucault, la littérature et les arts.
Dispositifs et création : textes, images, médias, arts.
Problèmes (de) critiques
Voies négatives et processus d'écriture : pour des outils théoriques en recherche-création.
2021-2023
La conversation médiatique et médiatée, entre civilité et socialité.
Pour une axiologie des arts et des lettres : valeur des œuvres et discours des valeurs.
2020-2022
Genres et sexualités dans la culture moderne et contemporaine (XIXe-XXIe siècles)
Littérature de voyage
2019-2021
Formes et fonctions du végétal dans les arts. Des processus de création aux modèles de réflexion
La retraduction : lieu et moment d'interprétation. Pour une histoire culturelle de la subjectivité en retraduction
2018-2020
Art(s) et Littérature(s)
Nouvelles mythologies et expérimentations narratives
2017-2019
La question de la métaphore
Traduction et recherche : traduire ce qui a disparu.
2016-2018
Régimes de vérité
2016-2017 ⇒ Antiquité – Renaissance – Age classique
2017-2018 ⇒ Antiquité – Modernité
La matière médiévale dans les arts et la littérature : résurgence, détournement, réappropriation.
2015-2017
Genre et cultures : œuvres de rupture.
2015-2016
Enjeux de l'intermédialité pour le théâtre contemporain
Lieux mineurs : dispositifs esthétiques et enjeux politiques.
2014-2016
Traités et théorie dans les arts et la littérature en Europe (XIVe-XIXe siècles)
2014-2015
Politiques culturelles et enjeux de l'intermédialité pour le théâtre contemporain
Images des lieux : dispositifs esthétiques et enjeux politiques.
2012-2014
Traductologie : histoire et démarche épistémologique.
Dispositifs et création : textes, images, médias, arts.
L'évolution des notions de « civil, civilité, civilisation » dans la pensée et la recherche universitaire
2011-2013
Foucault, la littérature et les arts.
Dispositifs et création : textes, images, médias, arts.